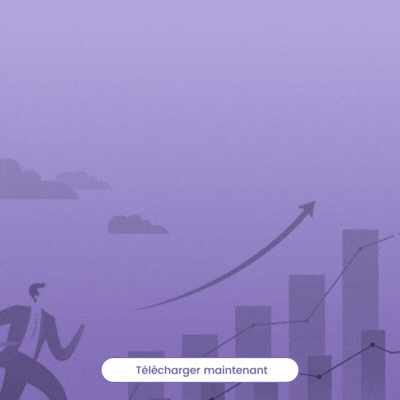Dix ans après la crise, si le monde n’a pas oublié celle qui frappa si durement les économies occidentales, ce même monde veut passer à autre chose. On connaît les réponses des politiques et des régulateurs à la suite de cette crise : plus de fonds propres, plus de réglementation, plus de contrôles, plus de sanctions… toujours plus. Mais était-ce les bonnes réponses ? N’a-t-on pas oublié de s’interroger sur les origines de la crise elle-même et, dès lors, les réponses apportées sont-elles adaptées au problème ? Car, au fond, en schématisant grossièrement, la crise est partie des États-Unis, du marché immobilier, du mode d’endettement des ménages et du mode de distribution des crédits hypothécaires. Ce qui veut dire que la crise est un problème américain et non européen, une question de fonctionnement des banques aux États-Unis et non en Europe, une interrogation sur le mode de vie américain.
Dix ans après, qu’en est-il ?
Afin d’éviter de devoir une nouvelle fois mettre la main au porte-monnaie des États, et donc des contribuables, pour renflouer les établissements défaillants, on aurait pu penser que les mesures réglementaires prises conduiraient à éviter une concentration du risque par la mise en place de freins en matière de regroupements entre banques. C’est l’inverse qui s’est produit, tout au moins aux États-Unis. Mieux, depuis la crise, les bilans des banques n’ont cessé de croître. Selon le FMI, depuis la crise, les banques, au niveau mondial, sont plus grosses et plus internationales. Bien sûr, un dogme est tombé : une banque peut faire faillite et des déposants peuvent perdre leurs dépôts. Depuis 2000, plus de 500 banques ont fait faillite aux États-Unis ; en Europe, les stress-tests de la BCE sont redoutables, notamment pour certaines institutions, comme près de soixante-dix banques régionales allemandes. On constate aussi une évolution du business model bancaire avec le passage du cross border banking au multinational banking, c’est-à-dire le modèle où les banques gardent une empreinte locale forte dans le cadre d’un réseau mondial. C’est le fameux « glocal ». Plus étrange est le procès fait au modèle de la banque universelle, mis à mal alors qu’il était plus résilient que les autres. L’Europe n’a pas su (ou pas pu) défendre son modèle alors même que la crise a montré que la diversification des activités et des sources de revenus constituait des protections efficaces en période de crise. Ainsi, le modèle qui sort vainqueur de la crise, c’est celui de la « marchéisation », c’est-à-dire du recours aux marchés financiers pour accompagner le développement des entreprises et des ménages. La réglementation issue de la crise incite les agents économiques à se financer via le marché, et moins via leurs banques.
Conséquence logique, une place de plus en plus importante est faite au shadow banking dans le financement de l’économie : 92 000 milliards de dollars (en 2015), soit 60 % du système bancaire, et plus tiers du total des actifs financiers avec l’Europe en tête de peloton. Qui sont les acteurs de ce nouveau mode de financement ? Les fonds d’investissement, qui représentent un gros tiers du total avec 30 000 milliards de dollars, puis les courtiers avec un peu moins de 10 000 milliards de dollars, et enfin les hedge funds avec « seulement » 3 200 milliards de
Dix ans après, qu’a-t-on appris ?
Tout d’abord que l’esprit de lucre est une constante de l’humanité. C’est toujours le besoin de « gagner plus » qui guide l’action de l’homme, qu’il soit consommateur, trader, politique ou autre. La disparition progressive de l’acte gratuit, le rétrécissement de la sphère non marchande en sont les conséquences les plus visibles. Corollaire immédiat de ce premier constat, la faculté d’oubli par les hommes des crises précédentes est une caractéristique récurrente du monde financier : les générations de traders passent mais leur sagesse n’augmente pas avec le temps. Au point d’oublier que le métier de banquier doit rester un métier simple où il s’agit au final de gérer un risque de crédit sur un client.
Dix ans après, qu’a-t-on fait ?
On a vu tout au long de la crise et des années suivantes, de très nombreuses déclarations politiques, sur le registre : « plus jamais ça ! », « fauteurs, payeurs », « le contribuable ne doit plus payer les erreurs des banques ». L’Islande a même mis son Premier ministre en prison pour avoir conduit à la faillite de l’État ! Une certaine démagogie, pourrait-on dire. On a vu de « grandes messes » internationales réunissant les dirigeants politiques des « grands pays » avec des décisions prises au niveau international (FSB, G8, G20). Mais on peut s’interroger sur leur efficacité du fait d’un problème de gouvernance dans ces instances où seuls des « experts », de profil identique, sont présents (mimétisme comportemental, « pensée unique »). Surtout, on constate qu’il ressort de ces réunions qu’il s’agit pour l’essentiel d’une régulation macroprudentielle et moins d’un ajustement de la régulation microprudentielle. Jusqu’à la crise, la supervision financière n’intégrait que peu l’aspect macroprudentiel et il a été jugé nécessaire d’ajouter une telle « couche ». Or, il existe un débat – technique – pour déterminer si la régulation microprudentielle existant au moment de la crise a, du fait de sa procyclicité, amplifié ou non le risque systémique. Et si la régulation mise en place depuis la crise n’a pas trop insisté sur le caractère macroprudentiel au détriment du microprudentiel. À noter que, s’il n’existe pas de définition de ce qu’il convient d’entendre par régulation macroprudentielle, on s’accorde à considérer qu’elle permet d’anticiper les crises du fait de son caractère préventif. Comme l’indique le gouverneur Noyer, « il s’agit en effet de prévenir l’apparition de déséquilibres financiers, de phénomènes procycliques ou de risques systémiques en limitant la croissance excessive du crédit et de l’endettement des agents économiques ainsi qu’en augmentant, ex ante, la capacité d’absorption des chocs des institutions ou structures
Pourquoi les avancées structurelles sont-elles si difficiles ?
Tout d’abord, est-il encore besoin de rappeler que la crise est avant tout une crise de la dette : 152 000 milliards de dollars, soit 225 % du PIB mondial. On répond à cette crise de la dette par un déversement de liquidités sur le marché, conduisant… à une augmentation de la dette des ménages, des banques, des États, des banques centrales (le total de bilan de la BCE a dépassé en 2016 celui de la Fed avec 4 500 milliards d’euros à comparer à moins de 1 000 milliards avant la crise). En fait peu de personnes se posent la question qui fâche : cette crise n’est-elle pas une crise d’un modèle de société fondé sur l’endettement ? Mais qui accepterait aujourd’hui de voir une certaine décroissance de nos économies ? Deuxième raison : un mode de régulation où la concurrence réglementaire entre pays (ou zones économiques) reste forte pour attirer les affaires. Troisième raison : l’absence de remise en cause de certains principes de la finance de marché à la base de la crise : méthode de valorisation des actifs et de prévision des risques, avec le mythe de l’« homme rationnel » et la « rationalité » de la décision d’investissement, modèle d’évaluation des actifs financiers et, bien sûr efficience des marchés. Quatrième raison : la permanence d’une régulation fondée sur des principes néolibéraux (comme la primauté de la concurrence) et non sur le bien commun. Est-il possible de mettre des limites au développement des marchés ? Selon quel critère : bien commun, intérêt général ? Il s’agit de notions trop floues pour faire l’objet d’un consensus. Enfin, l’absence de volonté politique tant au niveau national qu’international pour modifier en profondeur le système financier.
Y a-t-il de l’espoir ?
Oui, heureusement. On voit émerger tout un courant de pensée critique vis-à-vis de la financiarisation de l’économie et prônant un retour à une finance au service d’une économie elle-même « enracinée ». Reste à s’accorder ensemble sur ce nouveau modèle économique.