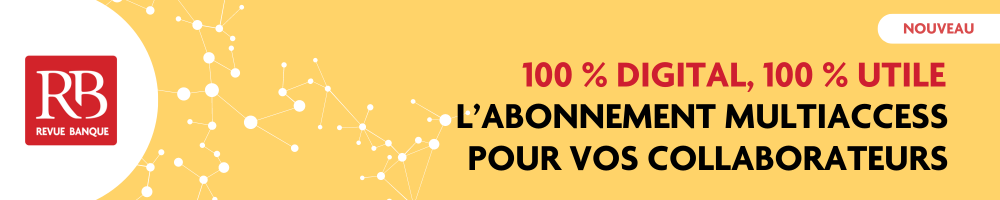Les autorités européennes de supervision, les ESA (EBA pour le secteur bancaire, Esma pour les marchés financiers et Eiopa pour les assurances et pensions professionnelles), viennent de publier chacune un “rapport intermédiaire” sur ce que l’on a coutume d’appeler le “greenwashing” dans le secteur financier.
Pour réaliser ces trois rapports, les ESA ont mené, entre novembre 2022 et janvier 2023, une consultation auprès de divers intervenants du secteur. Ils ont été interrogés sur leurs perceptions des entités et éléments de communication les plus susceptibles de greenwashing. Les ESA ont obtenu 136 réponses.
Elles se sont également basées sur des analyses quantitatives des cas de greenwashing présumé issues des travaux de la société RepRisk (un fournisseur de données ESG). Point méthodologique important : les cas répertoriés n’ont pas été rapportés par les consommateurs, clients, investisseurs ou les superviseurs mais principalement par des ONG et la presse, le bien-fondé des allégations n’a pas été vérifié par la société et ces cas présumés n’ont pas systématiquement donné lieu à des actions en justice ou des procédures de règlement de litiges.

Le climat en première ligne
Le rapport indique 206 cas supposés de greenwashing en 2022. Ils se déclinent principalement dans des problématiques environnementales et sociales. Les questions relatives à la gouvernance, aux pratiques anti-concurrentielles, à la corruption, au blanchiment d’argent, à l’évasion fiscale, sont relativement peu présentes. Le secteur bancaire représente 23 % du total des cas présumés de greenwashing impliquant des entreprises européennes. Le climat constitue dans ce cas le sujet qui arrive en tête.
Près de 56 % des répondants à la consultation des ESA considèrent que les engagements des entités bancaires en termes de trajectoire, de plan de transition, de cibles, sont les plus susceptibles d’une communication trompeuse, surtout via une sélection des informations qui se concentrerait “uniquement sur les aspects positifs” et omettrait “délibérément des données négatives tout aussi pertinentes” (selon 69,11 % des répondants). 58,83 %, enfin, considèrent que les entités peuvent se livrer à des “mensonges purs et simples” sur ces sujets. Davantage que les produits et services commercialisés, ce sont les stratégies des entreprises qui sont pointées.
Il reste cependant à déterminer dans quelle proportion leurs activités, par nature, n’exposent pas inéluctablement les banques à des présomptions de greenwashing. Multifactoriel et polymorphe, celui-ci ne peut être simplement imputé à des intentions malhonnêtes. Le rapport de l’EBA précise d’ailleurs que les acteurs bancaires, conscients des risques de greenwashing, déclarent avoir besoin de “définitions claires et de méthodologies”, qui leur font aujourd’hui défaut. S’agissant des banques, le risque qui retient le plus l’attention des autorités est celui dit “de réputation”, avec pour corollaires un retrait possible de la confiance des investisseurs et une difficulté à fournir les financements nécessaires.
Qu’est-ce que le greenwashing ?
Le concept de greenwashing est parfois assené comme une évidence. Le droit européen, cependant, laisse la possibilité d’une incohérence entre les approches des institutions. C’est pourquoi l’EBA, l’Esma et l’Eiopa se sont au préalable accordées sur une définition commune. Elles définissent le greenwashing comme une “pratique selon laquelle des affirmations, déclarations, actions ou communication relatifs à la durabilité ne reflète pas clairement ni de façon loyale le caractère de durabilité sous-jacent d’une entité, d’un produit financier ou de services financiers”.
Une fois ce point posé, dans une Europe où les dirigeants peinent eux-mêmes à s’entendre sur le caractère de durabilité ou non de certaines activités économiques, la notion de “greenwashing” est à manier avec précaution et l’évaluation des pratiques reste délicate.
Le rapport pointe bien une “augmentation claire du nombre total des cas potentiels de greenwashing dans tous les secteurs, y compris celui des banques européennes” depuis 2012. Il précise que cette hausse est allée de 40 cas en 2018 à 206 en 2022. L’Autorité bancaire européenne (EBA), cependant, mentionne que le greenwashing est aussi le pendant d’une attente dont l’émergence est relativement récente. Le grand public est aujourd’hui davantage sensibilisé sur les questions “environnementales, sociales et de gouvernance”, générant une exigence accrue sur ces sujets.
Elle rappelle également que l’encadrement législatif, et notamment la taxinomie, n’est pas abouti, mais encore que les obligations légales se sont considérablement étoffées en quelques années. Sans compter que les divers attendus réglementaires ne sont pas forcément coordonnés : leur application n’en est que plus complexe.
Pour l’heure, les ESA ne formulent pas de recommandations. Les rapports finaux sont attendus en mai 2024. D’ici là, l’efficacité et l’opportunité des normes réglementaires en vigueur doivent être scrutées, ainsi que leurs lacunes éventuelles. Les ESA prévoient d’ores et déjà de clarifier et préciser certains points.
La crédibilité en termes de finance durable se joue sur deux tableaux complémentaires : la capacité des banques à se conformer aux attendus réglementaires et à réellement financer la transition énergétique mais aussi l’adéquation du cadre législatif lorsqu’il s’agit de leur donner les moyens d’y parvenir.