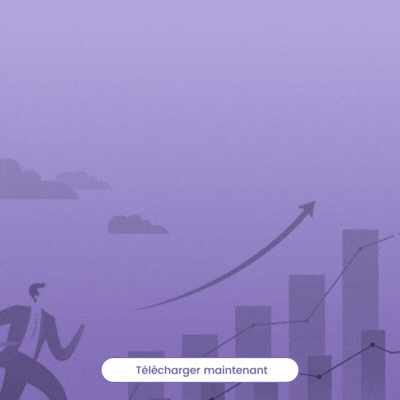lTibi 1 avait mobilisé 23 investisseurs institutionnels partenaires en 2020-2022. Tibi 2, lancé il y a près d’un an, en réunit 30. Quelles sont les différences entre ces deux phases de l’initiative qui porte votre nom ?
La première différence réside dans le type de fonds. La phase 1 portait sur le late stage non coté et la global tech cotée (retrouvez ces termes dans le lexique). En juin 2023, nous avons intégré une troisième poche de financement : l’early stage non coté. Nous sommes soucieux d’alimenter l’écosystème à la racine, et sur notre territoire. Nous pensons qu’il est indispensable d’intégrer des projets de financement industriel risqués – comme de financement de SPV ou de spin-off (activités séparées pour former une entreprise indépendante, ndlr) d’entreprises françaises, cotées ou non cotées – toujours dotés d’une composante technologique.
Il y a aussi une différence d’ordre technique. Pour des fonds de type « transition » énergétique, écologique, etc., nous avons admis que le taux d’intensité technologique peut descendre à 50 %, contre 80 % en règle générale.
La cible est donc plus large. En montants, 7 milliards d’euros sont cette fois annoncés d’ici fin 2026, pour 6 milliards d’euros mobilisés sur trois ans en phase 1. Est-ce suffisant dans un contexte de besoin de financement massif des transitions écologique, numérique et industrielle ?

Ce n’est jamais assez ! La demande de capital des fonds est très importante. Nous espérons sensiblement augmenter le nombre d’investisseurs nous rejoignant, ainsi que les montants promis. Le président de la République a annoncé une ambition de 10 milliards d’euros : cela reste l’objectif.
La remontée de taux, le contexte géopolitique et l’atonie de la bourse pour les sorties le permettent-ils ?
Les modèles d’allocation d’actifs des LPs se sont clairement resserrés par rapport à la première phase. Celle-ci avait été lancée dans une période de taux négatifs, plus favorable à l’investissement dans des actifs illiquides et risqués. Les conditions financières étaient très restrictives en 2023, au début de la seconde phase, mais nous constatons que le flux d’investissement s’est poursuivi à un rythme convenable. Nous espérons évidemment que la baisse des taux attendue par le marché aura des effets favorables. En tout état de cause, les assureurs, ainsi que les family offices et corporates savent que la technologie est désormais une classe d’actifs à part entière et qu’elle offre d’excellents rendements.
Parmi les institutionnels, y a-t-il de plus ou moins bons élèves ?
Nous remercions tous ceux qui participent à l’initiative. Dans la gouvernance, chacun a une voix. Notre politique de principe est de réserver ce type de conversations à des entretiens bilatéraux. Je suis heureux de confirmer que l’engagement des LPs partenaires n’a jamais été un sujet pour quiconque. Ils participent activement à la vie de l’écosystème.
Quelles sont les instances de gouvernance ?
Nous avons un comité exécutif, avec des représentants des LPs, un représentant de l’État et un de BpiFrance : son rôle est de piloter l’initiative, d’examiner la candidature des partenaires qui souhaiteraient la rejoindre ou d’introduire une modification dans les cahiers des charges. Deux comités techniques ont la charge de la sélection des fonds cotés et non cotés. Les dossiers de sélections sont assez lourds et réclament un travail soutenu de la part de la mission et des membres de la gouvernance.
Vous avez remis votre rapport « pour lever le verrou du financement des entreprises technologiques » au ministre des Finances en juillet 2019. L’initiative qui en découle, « pour financer la quatrième révolution industrielle », a été lancée sous l’égide du président de la République. Comment s’articule-t-elle avec d’autres projets ou investissements publics, en particulier de BpiFrance ?
L’initiative repose à 90 % sur du capital privé. BpiFrance gère de l’argent public. Il n’y a pas d’articulation organique, mais des collaborations. Pour l’avenir, nous espérons une collaboration avec France 2030 (plan d’investissement de 54 milliards d’euros dans la lignée de France Relance, ndlr), dans sa partie « Innovation de rupture ». La dimension scientifique et technologique des projets aura été ainsi partiellement « dérisquée » : le capital privé pourra s’en saisir.
Les fonds de late stage/growth non cotés répondant aux critères du « label Tibi » sont de taille importante. Cela illustre-t-il un souhait de concentration dans le private equity ?
Non. La concentration existe, certains grands fonds ouvrent leur capital, c’est une bonne chose. Nous concernant, nous constatons plutôt une grande diversité d’offres, de styles de gestion, de profils de gérants ou de couple rendement-risque. Au total, la gouvernance a sélectionné plus de 120 fonds, dont déjà des « fonds successeurs » de fonds homologués lors de la phase 1.
Vos critères sont cumulatifs. Certains portent sur les équipes : être localisées en France, expérimentées, avec un historique à présenter ou encore être en capacité de mener une introduction en Bourse (IPO). Pourquoi leur demander d’anticiper les IPO ?
Les sorties de fonds ont lieu sous forme de vente à un industriel (ou à un autre fonds) ou d’IPO. Dans la mesure où nous cherchons à faire émerger des leaders français à vocation européenne ou internationale, nous préférons les IPO à l’absorption par des grands groupes, qui sont d’ailleurs souvent américains dans les activités qui nous intéressent. Les gérants doivent donc avoir des compétences sur le sujet ou gagner en compétence, motivés par notre agrément.
Les équipes doivent aussi faire des efforts pour intégrer l’ESG...
Cela répond à une demande des investisseurs institutionnels. Pour lever des fonds, il faut répondre à l’article 9 ou l’article 8 (avec un objectif d’investissement durable dans le règlement SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation, ndlr). Le cahier des charges prend acte des pratiques actuelles : la quasi-totalité des fonds que nous avons labellisés sont au moins article 8 (avec des caractéristiques environnementales et/ou sociales avec des pratiques de bonne gouvernance, ndlr). L’accord d’engagement des investisseurs aussi met l’accent sur les enjeux de souveraineté, le financement de la Deeptech (des projets portés par des entreprises ou des laboratoires de recherche qui repoussent les frontières technologiques avec des innovations de rupture dans tous les domaines, ndlr), ou encore la transition énergétique et écologique.
Comment l’homologation se déroule-t-elle ? Y a-t-il beaucoup de dossiers rejetés ?
Les dossiers sont adressés à la mission, à la Direction générale du Trésor. Le rôle des comités, pour le coté et le non-coté, est d’auditionner les équipes sur la base de leur thèse d’investissement, leur équipe, leur track record, leur politique ESG, etc. Ces éléments sont documentés dans un dossier établi par les candidats, sous leur responsabilité. L’audition est ensuite un grand oral de 10 minutes ! La mission est dans une posture d’accompagnement bienveillant, même si nous sommes très exigeants sur la qualité des projets.
Nous présentons les dossiers qui le méritent, selon nous, à la gouvernance – qui les homologue, ou pas. Nous sommes très attachés à la transparence des process et à l’égalité des chances des candidats. C’est pourquoi, par exemple, la chronologie des présentations des candidats est organisée par un algorithme qui dépend essentiellement des recommandations des LPs. Il est légitime que ceux-ci examinent d’abord les fonds qui leur paraissent les plus intéressants. Ce process a permis d’auditionner très tôt des fonds de toute nature, dont des first time teams, first time funds.
Les fonds homologués sont-ils contrôlés ? Peuvent-ils être sanctionnés ?
Dans deux cas, des sanctions ont été prononcées à l’encontre de fonds qui n’ont pas respecté leurs promesses initiales. Ces promesses les engagent. Comme pour toutes les décisions structurantes du projet, la gouvernance a le dernier mot. Le second cahier des charges est plus strict que le premier, à cet égard, car il interdit à une société de gestion défaillante de présenter des fonds successeurs à l’homologation.
Que retenez-vous des cinq premières années ?
En premier lieu, ce sont les incitations qui fonctionnent, bien plus que les prescriptions : les assureurs, tout à fait libres de leurs investissements dans un périmètre qu’ils ont eux-mêmes choisi et qui est conforme à nos critères, ont finalement plus investi dans le non-côté que nous l’avions prévu. La gouvernance des LPs doit donc être maintenue, avec ce choix collectif d’homologation des fonds.
De plus, la France bénéficie d’un écosystème dans le non-coté qui la place très loin devant les autres pays de l’Union européenne (UE), avec 20 milliards d’euros investis dans les fonds labellisés non cotés. Dans trois ans, ce total sera sans doute supérieur à 35 milliards, avec au moins dix fonds gérant plus d’un milliard d’euros.
Quel est l’ordre de grandeur dans ces autres pays européens ? Et aux États-Unis ?
Au sein de l’UE, en Allemagne ou en Suède, les montants investis en venture capital s’élèvent à quelques milliards seulement. S’il faut comparer aux États-Unis, c’est à l’échelle de l’Europe, non de la France. Mais ne soyons pas impatients. On ne rattrape pas les 60 ans d’investissements des États-Unis en cinq ans. C’est le travail d’une génération. L’UE ne s’est vraiment mise en ordre de marche pour le venture capital qu’en 2017-2018, après avoir pendant longtemps enregistré des flux 5 à 10 fois plus faibles que les investissements adressés à la Chine et aux États-Unis. Cet écart devient plus raisonnable depuis à peine deux ans, avec une proportion d’argent investi en ligne avec le PIB européen.
Les investissements dans les start-up européennes viennent aussi des États-Unis...
Le marché allemand est plus particulièrement dépendant des fonds américains. C’est structurel, compte d’une culture equity bien plus récente en Allemagne. S’est ajouté un effet conjoncturel : les investisseurs américains ont réduit la voilure dans l’UE depuis deux ans. Il y a bien un hiatus dans les statistiques entre la nationalité des investisseurs et celle des start-up. Mais nous ne trompons pas : la France et l’Allemagne ne sont pas rivales. L’UE est un bloc économique qui doit accentuer sa politique industrielle, en ce qui concerne la technologie. Nos rivaux sont les États-Unis et la Chine, pas d’autres pays européens.
La Place de Paris est mobilisée. Le rapport du comité d’experts présidé par Christian Noyer sur son attractivité va maintenant être rendu public. Qu’en attendez-vous ?
Nous souhaitons poursuivre l’internationalisation dans le cadre de l’initiative, par l’intégration de gérants d’actifs. Les équipes doivent être en France : c’est un de nos critères. Si des dispositions d’attractivité y aident, c’est l’essentiel : sur le modèle de la City de Londres.
Les travaillistes ont désigné le private equity comme une cible d’imposition future en vue des prochaines élections britanniques...
Nous avons en effet été approchés par des partis politiques britanniques... La Grande-Bretagne comme la Suisse ne sont pas dans l’UE mais sont des pays de grande tradition technologique. Je répète que nos véritables concurrents sont maintenant les États-Unis. Nous devons donc faciliter les accès, la réciprocité de pays certes hors UE, mais européens.
Que manque-t-il aux Allemands, qui nous envient votre initiative, pour motiver les investisseurs institutionnels à investir davantage ?
L’Allemagne travaille à un projet comparable depuis l’automne dernier. Les assureurs allemands sont soumis à la directive Solvabilité 2, comme les français, mais ont davantage de contraintes d’actif-passif du fait de garanties sur l’épargne. En attendant, Allianz fait partie des LPs de notre initiative et joue un rôle important dans l’écosystème français.
L’Allemagne s’est aussi intéressée au fonctionnement du PEA français et a travaillé à une réforme de son épargne retraite...
La culture de l’equity est un vrai sujet en Europe. Les fonds de pension n’investissent plus en equity au Royaume-Uni ! La place de la gestion active devient inquiétante face aux ETF. La prolifération de la gestion benchmarkée pose un problème de granularité du marché actions en Europe. Ces fonds-là ne participent pas, ou peu, aux IPO.
Ce problème est européen, et nous pensons qu’il doit être traité au niveau politique en Europe, tout en respectant l’autonomie de gestion des asset managers.
Les pays membres peuvent-ils partager de bonnes pratiques, notamment pour favoriser l’investissement long terme ?
En Europe, les fonds publics sont très limités, en raison d’une dette problématique et de politiques budgétaires beaucoup plus contraintes qu’aux États-Unis et en Chine. Pourtant la géopolitique et le climat imposent un reset économique de très grande ampleur. L’unité de compte est ici la centaine de milliards, quand on examine les besoins énergétiques, écologiques, agricoles et militaires. Les fonds publics n’y pourvoiront pas, c’est pourquoi il est indispensable de mobiliser l’épargne privée européenne pour la transformer en capital. C’est l’un des objectifs de l’Union des marchés de capitaux. Soyons cependant conscients que le problème européen est l’addition de problèmes nationaux. C’est pourquoi il appartient au politique d’exprimer une stratégie claire et ambitieuse, dans chaque pays.
Aboutir dans l’Union des marchés de capitaux (UMC), est-ce la recette ?
Mon approche est complémentaire de l’UMC, un projet critique pour l’Europe. Je crois à une démarche bottom-up, resserrée sur cinq ou six pays de l’Union européenne.
Propos recueillis par Sylvie Guyony
le 9 avril 2024