Le ratio dette publique sur PIB s’est imposé, depuis son inscription dans le Traité de Maastricht, comme l’un des critères privilégiés d’évaluation des politiques économiques. Si l’on connaît parfaitement le seuil de 60 % à ne pas dépasser, le mode de calcul du ratio et l’interprétation économique qui en résulte sont loin d’être clairs. Une dette peut en effet être valorisée de trois manières, qui conduisent à des ratios dette/PIB totalement différents : la valeur nominale, la valeur de remboursement et… la valeur de marché.
Les textes de Maastricht, qui ont le mérite de la simplicité, imposent de valoriser la dette publique à sa valeur nominale. Le ratio est donc précisément « valeur nominale de la dette publique/PIB ». On comprend ce choix en 1992. Les instruments de dette de l’État étaient essentiellement « vanille », avec dans le cas des obligations un remboursement égal, in fine, à la valeur nominale, sur laquelle sont assis les intérêts versés chaque année, qui entrent dans la dépense budgétaire. Le contrôle de la valeur nominale de la dette permet en conséquence de maîtriser le montant des intérêts, et donc le déficit budgétaire.
Un marché qui s'est sophistiqué
L’argument originel est clair et légitime. Mais les instruments de financement de la dette publique se sont beaucoup diversifiés depuis les années 1990, avec d’une part un très fort développement des obligations indexées sur l’inflation, et d’autre part l’émergence d’un marché primaire de zéro-coupon. Sait-on par exemple que 25 % du stock de la dette d’État britannique (12 % en France) est aujourd’hui indexé sur l’inflation ? La Grande-Bretagne a ainsi procédé en 2013 à une émission d’obligations indexées à… 55 ans, de taux-coupon 0,125 %, bien sûr largement inférieur au taux nominal sur une maturité identique.
Un simple petit calcul doit nous faire réfléchir sur la signification du ratio dette/PIB, qui n’enregistre au numérateur que la valeur nominale de la dette, et non sa valeur de remboursement : un taux d’inflation moyen de 3 % conduit à une valeur de remboursement égale à 5 fois la valeur nominale empruntée, un taux de 4 % à… 9 fois. Bien sûr, le PIB est lui-même indexé sur l’inflation, mais l’économie est alors significativement exposée au risque de stagflation, caractérisée par une stagnation de l’activité économique associée à une forte inflation, dont la conséquence est une forte augmentation du besoin de financement et un risque de crédit accru sur la dette souveraine. La question désormais posée est celle du sens économique du ratio dette publique/PIB, dans un environnement caractérisé par le développement d’instruments de financement ne distinguant plus les flux d’intérêt et les flux de capital, faisant donc disparaître l’argument originel des concepteurs du Traité de Maastricht.
Un indicateur dénué de sens
L’agrégation de valeurs nominales relatives à des obligations classiques, des obligations indexées sur l’inflation et des obligations zéro-coupon donne un indicateur de dette hétérogène, sans grand sens économique. Il n’est pas possible de convertir le stock ainsi mesuré en flux d’intérêt, dans une logique de contrôle des intérêts versés, puisque les zéro-coupon ne versent pas de coupon (!) et les obligations indexées sur l’inflation versent un coupon « réel » très faible, voisin du coupon nominal minoré de l’inflation anticipée. Sur les deux derniers titres, les intérêts sont en réalité intégrés dans le capital remboursé à l’échéance, sur lequel le ratio dette/PIB est totalement muet. Prenons l’exemple de la Grande-Bretagne, dont la dette nominale totale est d’environ 1 400 milliards de livres sterling, composée d’obligations indexées sur l’inflation à concurrence de 326 milliards (voir Graphe 1). Tout décalage entre le taux de croissance du PIB nominal et le taux d’inflation dégrade rapidement ratio dette/PIB, ce que montre le Tableau 2.
Plutôt que la publication d’un ratio dette/PIB instantané, ne serait-il pas raisonnable de demander aux États de produire la projection de ce ratio sur un horizon de long terme, sur la base de simulations du taux d’inflation et du taux de croissance du PIB en volume, afin d’identifier les trajectoires conduisant à l’aggravation du risque de crédit. De la distribution des ratios issue de la simulation, pourrait être déduit un quantile, assimilable à la Value at Risk, qui mesurerait le ratio-catastrophe et obligerait les États dont le niveau de risque est trop élevé à réajuster la structure de leur portefeuille de dette. On aurait alors basculé dans une approche en termes d’insolvabilité, et non plus de maîtrise du service de la dette développée en 1992 dans une logique budgétaire.
Mais on peut aussi se demander si le ratio dette publique/PIB ne servirait pas à mesurer la capacité d’un État, non pas à assurer le service de la dette, non pas à rembourser cette dernière, mais à la… racheter. Au fond, il n’est pas inintéressant de se demander quelle fraction du PIB pourrait permettre à l’État de racheter sa propre dette. Dans cette logique, le numérateur du ratio devient la valeur de marché de la dette et les meilleures élèves de la classe les pays dont la dette est la plus décotée sur le marché. Logique d’apparence absurde, mais qui est bien celle sous-jacente à l’évaluation comptable à la « juste valeur » de la dette privée émise, qui permet aux banques et aux entreprises (changement prévu dans la norme IFRS9) de dégager un résultat positif dans l’hypothèse de la dégradation de la qualité de crédit de leur propre dette.






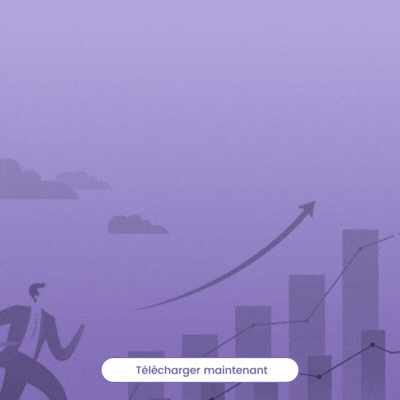
![[Web Only] Tarifs bancaires : les banques amortissent l’inflation [Web Only] Tarifs bancaires : les banques amortissent l’inflation](http://www.revue-banque.fr/binrepository/480x320/0c0/0d0/none/9739565/MEBW/gettyimages-968963256-frais-bancaires_221-3514277_20240417171729.jpg)




