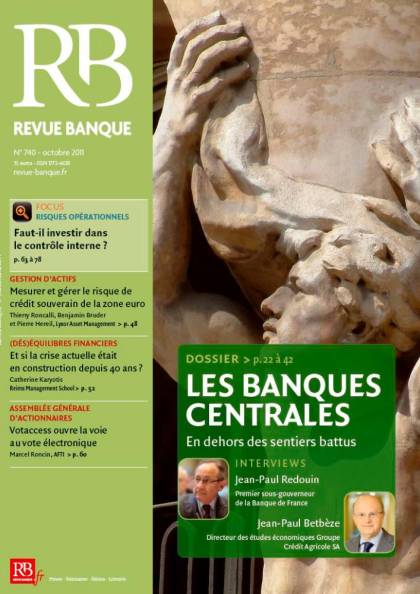> Lire aussi l'interview de Charles Wyplosz : « En intervenant, la BCE a semé le doute »
Est-ce le rôle d’une banque centrale d’acheter de la dette souveraine des pays qu’elle couvre ?
Le problème fondamental de la zone euro est que les pays qui la composent émettent une dette dans une monnaie dont ils n’ont pas le contrôle. Ils ne peuvent donc pas donner la garantie implicite à leurs créanciers qu’ils auront toujours les fonds pour payer, comme peuvent le faire le Royaume-Uni ou les États-Unis. Cela rend les pays de la zone euro vulnérables à des mouvements spéculatifs, caractérisés par une hausse des taux d’intérêt demandés et une fuite des capitaux du marché monétaire. Une crise de liquidité survient alors, suivie la plupart du temps par une crise de solvabilité, car la charge de la dette est augmentée. Ce phénomène a les mêmes caractéristiques qu'un bank run, lors duquel les dépôts sont échangés contre du cash. C’est ce qui arrive actuellement à l’Italie et l’Espagne, la Grèce souffrant, elle, d’un vrai problème de solvabilité. Face à une telle situation, la seule institution qui puisse réagir est la Banque Centrale Européenne (BCE), en garantissant l’accès à la liquidité.
Ces interventions ne créent-elles pas un risque d’inflation ?
Non. Elles ont un impact sur la base monétaire, puisque la banque centrale crée des liquidités supplémentaires, mais pas sur la masse monétaire, c’est-à-dire l’argent détenu par les agents économiques. En effet, ces liquidités sont fournies aux détenteurs des obligations souveraines rachetées : les institutions financières, au premier rang desquelles les banques. Celles-ci les thésaurisent et ne les réinjectent pas dans l’économie. C’est ce que l’on a constaté lors des interventions des banques centrales comme prêteurs en dernier ressort depuis plusieurs années.
Les réticences de la BCE à intervenir ne sont-elles pas justifiées au regard de l'aléa moral que cela créerait en faveur des États membres ?
Il s’agit du même aléa moral que lorsque les banques centrales ont massivement injecté de la liquidité dans les banques. Mais en période de crise, il faut faire des choix si l’on veut éviter le pire. Lutter contre l’aléa moral se joue en amont : de même qu’un superviseur est nécessaire pour empêcher les banques de prendre trop de risques, il faut mettre en place un système de contrôle mutuel des déficits et de la dette pour les États. Mais sans injection de liquidité, le système imploserait.
La BCE a-t-elle alors réagi trop tard ?
Le problème est surtout qu’elle hésite. La crise de gouvernance qui la touche, avec notamment la démission du représentant allemand Jürgen Stark, diminue l’efficacité de ses interventions. Cette absence de consensus est un vrai problème.
Le concept de prêteur en dernier ressort est bien plus problématique pour la BCE quand il bénéficie aux États plutôt qu’aux banques. Les deux rôles sont-ils comparables ?
Il revient beaucoup plus cher à une banque centrale de sauver les banques plutôt que les États, car la dette des premières est bien plus élevée : 250 % du PIB de la zone euro, contre 80-85 % pour la dette des États. Si la BCE ne résout pas la crise du marché obligataire souverain, elle risque d'être forcée d'intervenir plus tard au niveau du système bancaire.
L'indépendance de la BCE est-elle menacée par la crise de la zone euro ?
Non, pas du tout. Lorsque la BCE achète des titres d’État sur le marché secondaire, elle ne finance pas le déficit budgétaire, comme certains économistes le pensent. Les liquidités qu’elle injecte vont vers les banques détentrices des titres, pas vers les gouvernements. Ce sont des opérations d’open market sur des titres négociables sur les marchés, telles que les autorisent les statuts de la BCE.
Que penser, alors, de la clause de non-renflouement du Traité de Maastricht ?
Là aussi, il y a malentendu : l’article dit qu’aucun État ne peut être forcé à reprendre la dette d’autres membres. Il n’interdit pas d’apporter un support financier à un pays en difficulté.
La BCE pourrait-elle laisser l’inflation s’accroître pour réduire le niveau d’endettement ?
J’ai une certaine sympathie pour cette idée mais il faut faire attention. Cela a fonctionné dans l’Europe d’après-guerre, alors que l’inflation se maintenait à 5 % en moyenne, dans des pays où l’État avait un fort contrôle sur les institutions financières. Il pouvait les obliger à détenir les titres publics, alors qu'aujourd’hui, ces dernières réclameraient des primes de risque plus élevées.
Par ailleurs, la cible de 2 % d’inflation de la BCE est trop faible. Viser 3 ou 4 % me semblerait mieux adapté, mais ce point est devenu tabou, en particulier pour les Allemands : ils oublient qu’avant l’euro, leur inflation était supérieure de 3 points à son niveau actuel.
En cas de forte dégradation de la qualité des titres détenus, la BCE devrait-elle augmenter son capital ?
Ce ne serait pas nécessaire : les seules organisations qui n’ont pas à se soucier de faire des pertes, ce sont les banques centrales. Prenez l’exemple récent de la Banque Nationale Suisse qui subit d’importantes pertes suite à son intervention sur les marchés des changes.
Quelles sont les limites ?
Si, pour combler ces pertes, la création monétaire est très importante, cela pourrait avoir à terme un effet sur l’inflation. Mais la BCE est très loin de ce scénario. Là encore, des mythes circulent, laissant à penser que les États devraient accroître le capital des banques centrales en cas de pertes : ce n’est pas nécessaire.
Achevé de rédiger le 17 septembre 2011