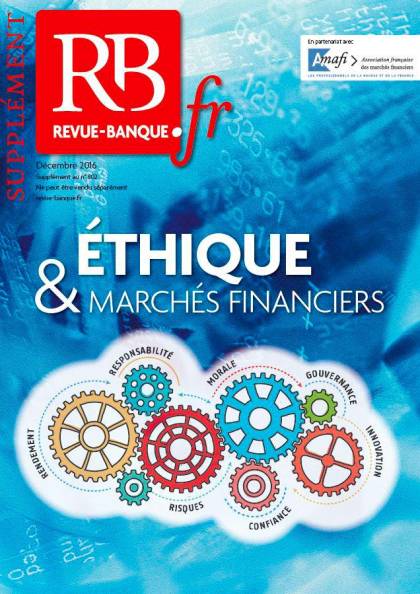L’idée que je propose dans cet article est très simple et peut se résumer de la manière suivante : l’éthique mise en œuvre par les professionnels sur les marchés est pour le moment réduite à une seule de ses dimensions, l’éthique déontologique ; il manque à l’éthique des marchés une seconde dimension, l’éthique épistémique. Sans cette dernière, l’éthique déontologique non seulement n’améliore pas le fonctionnement des marchés financiers, mais elle peut même contribuer à le dégrader, car l’application rigoureuse de bonnes règles de conduite peut renforcer de mauvais savoirs collectifs. Pour le dire autrement, un surcroît d’éthique déontologique accompagné d’un déficit d’éthique épistémique contribue à accentuer le dysfonctionnement des marchés financiers et à produire une perte de confiance du grand public dans la finance de marché. Il vaut mieux ne pas avoir un comportement éthique au sens déontologique si l’on n’a pas simultanément un cadre éthique au sens épistémologique. Sans éthique épistémique, l’éthique des marchés est vouée à l’échec.
De l’« éthique des actions » à celle du savoir et des croyances
Pour préciser cette idée, commençons par définir les deux éthiques, avant de prendre comme exemple le procès Kerviel et la crise financière de 2008.
L’éthique déontologique, ou « éthique des actions » prises par les acteurs professionnels, renvoie au devoir d’« agir comme il faut », conformément à des règles de bonne conduite, de ce qu’on appelle parfois aussi « éthique des affaires » – par exemple, ne pas chercher à abuser de la confiance de son client ou de son employeur, ne pas chercher à masquer le contenu réel d’une position, ne pas tricher dans une transaction financière, etc. C’est ici le domaine de la conformité, des codes de déontologie et des règles de bonne conduite. En résumé, dans l’éthique déontologique, ce qui compte est la rectitude d’intention, le devoir de bien agir, de suivre les règles. Du point de vue juridique, une faute morale dans le domaine de l’éthique déontologique relève du pénal. Ainsi, par exemple, les grandes fraudes financières, comme l’affaire Kerviel l’a récemment illustré, ont été jugées au pénal.
L’éthique épistémique renvoie quant à elle au savoir (épistémé, en grec), aux notions que l’on utilise, à ce que l’on croit, par exemple, sur la nature du risque financier, sur un rendement futur attendu, etc. C’est ici le domaine du croire (en anglais, ethics of beliefs), que ce croire concerne des méthodes de gestion, des modélisations probabilistes du risque ou des scénarios économiques. Ces savoirs sont logés à l’intérieur des outils de gestion qu’ils servent à construire et dont ils sont comme le reflet matériel – comme une feuille de calcul d’un tableur, un progiciel de calcul de prix d’option, un outil de suivi des risques globaux, etc. Du point de vue juridique, une faute morale dans le domaine de l’éthique épistémique relève du civil.
L’affaire Kerviel est très instructive sur cette dimension de l’éthique et je vais maintenant illustrer comment s’articulent les deux éthiques en considérant la récente révision de ce procès. Il ne s’agit pas ici de prendre parti pour ou contre Jérôme Kerviel ou la Société Générale, mais d’utiliser un cas récent connu pour comprendre la différence et l’imbrication entre les deux éthiques, et l’importance de l’éthique épistémique pour les marchés financiers.
Les deux formes d’éthique du procès Kerviel
On a vu, au cours de sa révision, comment le procès Kerviel a révélé une autre dimension du problème de la Société Générale : une défaillance des dispositifs collectifs de gestion qui a conduit l'avocat général Jean-Marie d'Huy à déclarer devant la cour d’appel de Versailles que la banque a « commis des fautes civiles, distinctes et de nature différente des fautes pénales de Jérôme Kerviel, qui apparaissent suffisantes pour entraîner la perte totale de son droit à réclamer une compensation intégrale de ses pertes ». Cela ne signifie pas que, pénalement, Jérôme Kerviel soit innocent, mais que, au civil, les dispositifs collectifs de gestion ont créé les conditions potentielles d'une fraude : « La Société Générale a laissé, en toute connaissance des imperfections […] de son système de contrôle interne, le champ libre aux velléités délictuelles de Jérôme Kerviel. Cela ne signifie pas que la Société générale puisse être considérée comme auteur ou complice des infractions commises par Jérôme Kerviel, mais cela signifie que les fautes de la première ont rendu possibles celles du second et en ont aggravé les conséquences. »
Les implicites moraux de la théorie financière
Revenons sur ce point très important. Dans la conférence finale des États généraux du management de 2010 intitulée « La place des sciences de gestion dans la culture contemporaine et dans l'après-crise », Armand Hatchuel, professeur à Mines ParisTech, a insisté sur le fait que, à l’exception des comportements frauduleux, « les crises les plus graves sont engendrées par des dispositifs collectifs de gestion dont les effets inattendus prennent totalement par surprise les professionnels ». Qu’est-ce que cela veut dire concrètement ? Que, contrairement à une croyance répandue, les outils de gestion ne sont pas les serviteurs zélés de décisions humaines, fussent-elles bien orientées par l’éthique déontologique (avec rectitude d’intention et prise en compte des règles de bonne conduite) ; bien au contraire, plutôt que « bons serviteurs », les outils de gestion sont bien souvent des « traîtres » qui orientent les décisions déontologiquement bonnes dans des directions non souhaitées. Pourquoi ? Parce que les finalités de la théorie financière sous-jacente à ces outils ne sont pas nécessairement alignées sur celles des objectifs déontologiques. La modélisation mathématique financière contient des implicites moraux. Par exemple, la théorie financière à l’œuvre dans les dispositifs collectifs du système de contrôle interne de la Société Générale reposait sur l’hypothèse de l’efficacité informationnelle des marchés dans laquelle le suivi d’une position n’est scruté qu’à l’aune de la différence des encours, et non des encours (ou nominaux) eux-mêmes. Cela ne veut pas dire que le système de contrôle interne était « faux », mais qu’il était au contraire parfaitement « vrai » au regard de la théorie financière d’arrière-plan qui le sous-tendait. De ce point de vue, la Société Générale était professionnellement au fait de la théorie financière et appliquait rigoureusement et avec méthode les outils de cette théorie. Le problème est venu de ce que les énoncés théoriques des modélisations du risque étaient défaillants : ils n’avaient pas été contrôlés du point de vue de l’épistémologie, la branche de la philosophie qui analyse les savoirs et leur pertinence. Ainsi, il y a eu manque de vigilance épistémologique, qui a conduit à une défaillance d’éthique épistémique.
Le rôle de la théorie financière dans la faillite d’AIG
J’insiste sur ce point : les outils de contrôle interne du risque transportent des représentations scientifiques élaborées par la théorie financière mathématique. Dans un article
Prenons l’exemple de la crise financière de 2008 et de la faillite d’AIG. Les ventes de CDS reposaient sur des modélisations mathématiques du risque dont les hypothèses probabilistes n’étaient pas corroborées par le comportement des marchés réels. La formule mathématique de la fonction de couverture reposait sur un paradigme de continuité des variations boursières, qui excluait toute rupture de cotation, tout événement rare, en un mot toute discontinuité. On se souvient de l'exclamation de Greenspan après la crise de 2008 : « nous ne pourrons jamais anticiper toutes les discontinuités des marchés financiers […] la gestion du risque finira toujours par échouer ». Or, dès 1962, et pendant toute la décennie qui a précédé le krach précurseur de 1987, les financiers avaient été mis en garde par le mathématicien Benoît Mandelbrot contre la simplification abusive induite par la continuité des modèles de la finance mathématisée. Mais à aucun prix les théoriciens américains de la finance ne voulaient quitter le paradis de la continuité, et la critique de Mandelbrot resta sans effet malgré les crises successives de la finance mondiale. Perseverare diabolicum est : à la suite du krach de 1987, les physiciens ont continué d’alerter les financiers sur les dangers de la continuité (ce fut la naissance de l’éconophysique). Nonobstant ces mises en garde et refusant toute critique sur les fondements de leurs modèles, les banquiers et les financiers ont continué à s’appuyer sur des outils de gestion façonnés par une théorie dont on savait désormais qu’elle était non corroborée par les études statistiques des marchés.
Définir des « vertus épistémiques »
Dans un remarquable
Comment décider ce que nous devons croire ?
Terminons en posant la question suivante : quel contrôle, et par suite quelle responsabilité, avons-nous à l’égard de nos croyances ? Comment décidons-nous ce que nous devons croire ? Comment tenons-nous pour vraies des propositions comme : « la copule de Li permet la gestion des crédits hypothécaires subprimes » ou encore « le contrôle interne du risque ne doit suivre que les écarts et non les encours » ? Je rappelle que la distinction entre « foi » et « croyance » n’a pas d’équivalent en latin : le substantif fides (foi) correspond au verbe credere (croire). Est-ce la foi dans les modèles mathématiques transportés par le logos financier qui a empêché les banquiers de pratiquer les vertus épistémiques ? En tout cas, la question d’une éthique de la croyance est posée, en regard des accidents financiers survenus sur les marchés. Ma proposition est simple : c'est parce que le logos financier a imprégné les dispositifs collectifs de gestion du risque et de contrôle interne que ces dispositifs ont produit des effets contraires à ce qui était attendu… et que les accidents ont suivi (Société Générale, AIG). L’éthique déontologique n’a pas de prise sur ces problèmes, qui relèvent de savoirs techniques pour le moment absents de l’éthique des marchés. Les « machines » (« acteurs » non humains) peuvent encourager certaines décisions au détriment d’autres, indépendamment des « valeurs » déontologiques injectées dans une entreprise. La théorie financière n’est pas éthiquement neutre. Les dispositifs collectifs de gestion sont ainsi de puissants incitateurs moraux à agir, bien ou mal. Et, en l’occurrence avec la crise de 2008 et les accidents récents, mal. Pour évaluer le caractère éthique des théories utilisées, il est nécessaire d’entrer dans le détail technique des produits et outils de gestion qui les reflètent et de se demander – à l’instar de l’industrie pharmaceutique – si tel produit, avant de le mettre sur le marché, pourrait être dangereux à cause de ses composants théoriques. Ainsi, en 2008, ce n’était pas tant les produits qui étaient toxiques que les modèles probabilistes. La présence de modèles mathématiques toxiques dans les produits financiers a rendu ces produits dangereux, faute d’une vigilance épistémologique sur la théorie financière.
J’ai écrit ailleurs que la finance dite éthique ne le sera pas vraiment tant qu’elle restreindra sa démarche aux choix d’investissement (ISR, finance solidaire, etc.) et aux normes