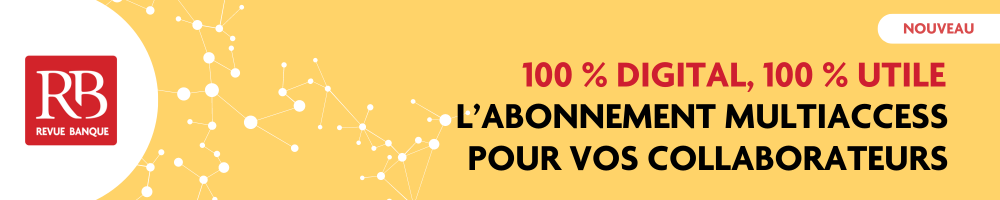Dès leur indépendance, les États francophones africains disposant de ressources naturelles ont adopté des lois relatives aux investissements étrangers et élaboré des textes spécifiques aux secteurs extractifs, les codes miniers et pétroliers, qui sont régulièrement modifiés ou
réformés
[1]
. Le particularisme de chaque projet extractif implique que ces codes soient complétés par des conventions signées entre l’État hôte et l’opérateur du projet extractif, afin de définir les droits et obligations respectifs des parties. L’objectif de ces conventions est de concilier les intérêts de l’État, de l’opérateur, mais aussi des populations, tout en tenant compte des réalités économiques, géologiques et des infrastructures disponibles ou à construire. Les conventions minières constituent, avec les titres miniers liés et le certificat (ou permis) environnemental et social, la clef de voûte juridique d’un projet minier par nature complexe, du fait de la multitude d’acteurs et de contrats tels que les conventions minières proprement dites, les contrats de sous-traitance conclus entre l’opérateur et ses différents sous-traitants, mais aussi les contrats de financement conclus entre l’opérateur et les apporteurs de fonds.
Financer le secteur minier : de la prospection à l’exploitation…
Si l’industrie minière se finance partiellement en réinvestissant les ventes des produits qu’elle extrait, transforme et commercialise, le seul autofinancement s’avère, sauf dans le cas de projets de très faible envergure, très insuffisant, en raison de l’ampleur des investissements à réaliser. Les besoins en financement extérieur varient selon les différents stades d’un projet minier et la capacité financière des sociétés minières :
- si, pour les majors de l’industrie minière, les phases de prospection et d’exploration sont généralement financées sur fonds propres, les sociétés juniors se tournent en revanche vers l’appel public à l’épargne, car les banques sont assez réticentes à financer ces phases marquées par un grand aléa. Plusieurs places boursières sont spécialisées dans le financement de juniors minières, notamment l’Alternative Investment Market (AIM), filiale du London Stock Exchange, mais aussi les Bourses de Toronto et de Sydney. Les sociétés juniors se financent également en ayant recours à des fonds d’investissement (private equity) ;
- pour la phase de construction (ou phase de développement), qui intervient postérieurement à l'exploration, les besoins financiers sont particulièrement manifestes pour les très grands projets, notamment dans le secteur du minerai de fer en Afrique, qui impliquent la construction non seulement d’une mine mais également des infrastructures énergétiques, de transport et
d’évacuation
[2]
. Ces infrastructures ne peuvent être financées que par des pools bancaires parfois avec l’appui d’institutions internationales en proposant des prêts à taux préférentiel ou en offrant des garanties pour l’exécution des
obligations contractuelles
[3]
;
- au stade de la production, les sociétés minières se financent, soit par autofinancement, soit en ayant recours aux banques, étant donné que le risque majeur à maîtriser est la gestion des coûts et de la production ;
- en phase d’exploitation, les sociétés spécialisées dans le trading minier peuvent également prendre des participations dans les projets et financent leur réalisation en s’assurant qu’elles auront l’exclusivité ou un droit préférentiel sur la vente du minerai.
Si les codes miniers soulignent la volonté de développer le secteur minier, son exploitation, l’ambition de favoriser les investissements, il convient néanmoins de constater qu’il n’existe aucun chapitre/section consacré au financement des activités minières. Les codes se concentrent en effet sur l’activité minière à proprement parler, sur les titres miniers, les obligations de l’opérateur ou encore le régime fiscal applicable à l’opérateur. Au niveau législatif, c’est davantage dans une législation éparse que l’on trouve des dispositions intéressant le financement : Code général des impôts, charte des investissements, accords bilatéraux de protection des investissements, conventions fiscales bi- ou multilatérales, acte
uniforme OHADA
[4]
relatif aux sûretés, loi sur les concessions ou partenariats publics-privés-PPP, etc.
Garantir la sécurité juridique
Les codes et conventions miniers contiennent des dispositions de nature à garantir une sécurité juridique aux investisseurs.
Les codes miniers prévoient traditionnellement des dispositions fiscales, douanières et des clauses dites de
« stabilisation »
[5]
, qui ont pour objet de remédier à l’aléa législatif, mais aussi des dispositions relatives à la nature des titres miniers (et par conséquent des sûretés qu’il est possible de prendre sur ces titres
miniers)
[6]
, à la participation de l’État au projet (qui influe nécessairement sur son financement), parfois à la propriété des espaces dans le périmètre
minier
[7]
et des infrastructures minières, complétées par les dispositions relatives à la protection contre les expropriations/nationalisations, au contrôle des changes, au rapatriement des bénéfices et à la possibilité de recourir à l’arbitrage international.
En ce qui concerne les conventions minières, les apporteurs de fonds ne sont bien souvent pas parties à ces conventions conclues entre l’État et l’opérateur. Dès lors, ces conventions qui se caractérisent, à l’instar de toute convention, par leur effet relatif, ne lient pas juridiquement les apporteurs de fonds à l’État ni à l’opérateur et contiennent peu de dispositions relatives au financement des projets. Néanmoins, certaines dispositions des conventions minières, intéressent les apporteurs de fonds en ce qu’elles participent à garantir la « bancabilité » du projet. Les dispositions d’une convention minière, modélisées économiquement, doivent permettre à la société de projet d’atteindre des Taux de rentabilité interne (TRI) compétitifs par rapport à des projets de développement de mine similaires, afin de convaincre les apporteurs de fonds de la viabilité économique et du caractère « bancable » du projet.
Si les premières générations de conventions minières contenaient peu de dispositions relatives au financement en sus de ce que prévoient les codes miniers et autres textes législatifs, les dernières générations contiennent des dispositions plus détaillées quant aux garanties offertes aux investisseurs en matière de sûretés, aspects fonciers, contrôle des changes, rapatriement des bénéfices, etc., et cherchent à faciliter le financement tel que le Modèle de l’accord pour le développement minier
(MMDA)
[8]
. Les conventions minières contiennent également de plus en plus souvent des dispositions relatives au respect de l’environnement et à l’impact social des projets, qui sont requises par les apporteurs de fonds. Ainsi, les sociétés minières internationales doivent se conformer aux principes de
l'Équateur
[9]
, qui sont des normes sociales et environnementales s’adressant au secteur financier et s’appliquant dans le cadre du financement des projets, et les dernières conventions minières y font expressément référence.
Les conventions minières peuvent également prévoir qu’au-delà des dispositions des législations nationales, les sociétés s’engagent à respecter des directives et bonnes pratiques promulguées par les institutions
internationales
[10]
, ainsi que des dispositions relatives à la lutte contre la corruption (références explicites au « UK Bribery Act » et au « Foreign Corrupt Practices Act » – FCPA) et à la transparence (normes
ITIE
[11]
notamment). De même, les droits des communautés établies autour des sites miniers sont pris en
compte
[12]
et les sociétés s’assurent qu’elles retirent de l’exploitation des minerais un avantage
économique
[13]
tout en garantissant un environnement sain et le respect des droits de l'Homme.
Les accords entre les opérateurs et les apporteurs de fonds
Les codes et conventions miniers permettent d’organiser les relations contractuelles entre l’opérateur et les apporteurs de fonds.
Les conventions minières, conventions-cadres, prévoient souvent l’existence d’autres accords et contrats conclus entre les parties à la convention minière, mais aussi entre l’opérateur, partie à la convention minière, et des tiers financiers. La convention minière peut ainsi prévoir l’existence des statuts de la société d’exploitation minière (SEM) dans laquelle l’État aura une
participation gratuite
[14]
(et le cas échéant à titre onéreux), d’un pacte d’actionnaires entre l’État et l’opérateur, précisant les dispositions desdits statuts et organisant les relations entre les actionnaires, mais aussi d’accords de financement, expressément décrits comme des accords conclus avec des tiers ayant pour objet le financement du projet ou de la SEM. Les statuts et le pacte d’actionnaires de la SEM prévoient souvent des dispositions plus détaillées relatives au financement de la SEM par l’opérateur, des tiers, et parfois l’État, qui intéressent les financiers, ainsi que les dispositions relatives aux cessions des titres et sûretés sur ces titres dans l’hypothèse notamment d’un éventuel « step-in ». La convention minière peut aussi anticiper sur les droits des apporteurs de fonds en prévoyant l’existence des accords de financement et que certaines dispositions de ces accords pourront primer sur les dispositions du pacte, des statuts, voire de la convention sous réserve de dispositions impératives du droit de l’État hôte.
Ce que ne disent pas les codes et conventions miniers…
Les codes et conventions miniers ne contiennent pas de dispositions relatives au montage financier de projets. Notons cependant que si toutes ces clauses sont destinées, d’une part, à rassurer les apporteurs de fonds et à limiter leur risque et, d’autre part, à organiser les rapports juridiques entre l’État, l’opérateur et les apporteurs de fonds, elles ne détaillent en aucun cas le montage financier de projet ou la structuration de la dette. Si chaque projet fait bien entendu l’objet d’une modélisation financière préalable, les codes et bien souvent les conventions miniers n’en font pas mention.
Dans le secteur des hydrocarbures, certains codes prévoient en revanche qu’une modélisation financière devra être annexée au contrat de partage de production. De même, les codes et conventions miniers sont bien souvent muets sur le financement des
infrastructures
[15]
à construire, alors que les infrastructures sont souvent la clé de la réussite de nombreux projets miniers. La réalisation des infrastructures à des coûts
compétitifs
[16]
(par rapport aux autres projets similaires dans d’autres pays) prend donc une acuité particulière, notamment dans le contexte international de volatilité des cours des minerais. Seuls les projets dont les coûts opérationnels sont compétitifs ont des chances d’être réalisés et le coût de ces infrastructures est une composante importante des coûts opérationnels. Or les codes et conventions miniers n'appréhendent pas ces sujets.
1
Voir le chapitre « Réformes des codes miniers et évolution de l’environnement réglementaire des secteurs extractifs en Afrique » écrit par Ludovic Bernet et Florent Lager au sein du
Rapport ARCADIA 2017, ed. Economica.
2
Voir Emmanuel Yoka et Florent Lager (2016), « Les investissements dans les infrastructures condition
sine qua non pour le développement des projets miniers au Congo », in Journal de la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération du Congo, hors-série, avril.
3
Voir les pages 291 et suivantes de l’ouvrage Thierry Lauriol et Émilie Raynaud,
Le Droit pétrolier et minier en Afrique, éd. LGDJ,
2016
.
4
Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires.
5
Bertrand Montembault (2003), « La stabilisation des contrats d’Etat à travers l’exemple des contrats pétroliers : le retour des dieux sur l’olympe ? »,
Revue de droit des affaires internationales n° 6.
6
Aspects juridiques de l'apport des titres miniers en garantie dans les Etats parties à l'OHADA", Thierry Lauriol et Tomasz Gawel, Revue de droit des affaires internationales, 2001, n° 2, p. 175.
7
Ludovic Bernet, Florent Lager et Gilbert Itoua (2014), « La sécurisation du foncier dans le cadre des projets miniers », Centre africain pour le droit et le développement (CADEV)-COJA.
8
Établi sous l’égide de l'Ordre international des avocats (IBA) avec la participation de la société civile et des groupes universitaires, le MMDA est consultable sur http://www.mmdaproject.org.
9
www.equator-principles.com.
10
Par exemple les Standards de performance et la politique de développement social et économique durable développés par la Société financière internationale, les recommandations de l’International Council on Mining and Metals (ICMM), les lignes directrices de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), etc.
11
Initiative pour la transparence dans les industries extractives : https://eiti.org.
12
Par exemple en République du Congo la loi n°5-2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones.
13
Banque Mondiale (2011), « Sharing Mining benefits in developing countries », Extractives industries for development series, 21 juin.
14
Les codes miniers prévoient en général une participation gratuite de l’État dans la société minière qualifiée de « free carry » (aux alentours de 10 à 15 %).
15
Dans certains pays d’Afrique francophone il existe une législation spécifique relative aux marchés publics, PPP concessif (type délégation de service public) et PPP non concessif (type PFI ou Contrat de Partenariat).
16
Olivier Fille-Lambie (2001), « Aspects juridiques des financements de projets appliqués aux grands services publics dans la zone OHADA »,
Revue de droit des affaires internationales n° 8.