La notation traditionnelle externe recherchant une présomption de défaut ne représente-t-elle pas le plus souvent une instruction « à charge », porteuse de conflit plus que de consensus constructif ? Il est le plus souvent difficile pour la PME de retourner l’appréciation à son avantage si elle est négative, dans un contexte d’asymétrie banque-entreprise qui lui est défavorable. On peut dès lors comprendre la perplexité, et parfois l’agacement, des dirigeants de PME qui se trouvent confrontés à des décisions dont ils ne comprennent pas toujours les
La messe est dite
Il est certes intéressant que l’entreprise puisse, depuis la loi Brunel du 20 octobre 2009, avoir le droit d’accès à sa note et à des explications. Cependant, même lorsqu’elle fait cette démarche (assez rarement, semble-t-il), elle n’est guère préparée à avancer une argumentation suffisamment solide pour faire bouger cette note et modifier l’appréciation de son interlocuteur. Trop souvent, « la messe est dite ». Pourtant, il serait dans bien des cas de l’intérêt même du partenaire financier de la PME d’opérer différemment, évitant ainsi de perdre une opportunité au prétexte de se couvrir contre un risque mal apprécié.
Partons d’un postulat auquel toutes les parties prenantes devraient pouvoir adhérer : il est de l’intérêt objectif commun de la banque et de l’entreprise que cette dernière prospère. Il faut pour cela que l’entreprise obtienne les financements nécessaires et suffisants pour assurer ses équilibres financiers présents et à venir, tant d’exploitation que de haut de bilan.
Cela implique :
- chez les dirigeants de PME, en plus de la volonté entrepreneuriale qui leur fait rarement défaut, une lucidité et une clairvoyance qui sont peut-être moins largement répandues chez eux ;
- chez leurs partenaires financiers, l’acceptation d’une image et d’une notation revisitées, sous condition naturellement d’une bonne visibilité sur les attendus et justificatifs de ces révisions.
Une autonotation
Revenons sur un constat : l’entreprise autant que la banque (ou l’assureur-crédit), mais chronologiquement avant elle, dispose du bilan fiscal qui est la base de sa notation. Dès lors, pourquoi l’entreprise ne pourrait-elle pas se noter elle-même, à condition bien sûr de pouvoir accéder à une méthode et aux outils ad hoc associés et d’être assistée par un conseiller professionnel, fort probablement son
Rehausser l'image et la note : du bilan fiscal au bilan économique
Mais allons plus loin encore. Comme évoqué dans notre précédent article, les comptes annuels souffrent d’un certain nombre de biais de nature à sous-estimer la solidité et la rentabilité de l’entreprise, et donc à sous-valoriser sa note. Si l’on donne les moyens à l’entreprise d’estimer et de justifier une revalorisation de certains éléments de ses comptes, par des correctifs explicités qualitativement et validés par un professionnel, le chef d’entreprise sera mieux armé pour défendre ses crédits de fonctionnement et
Ainsi, un quantitatif réapprécié à sa
- si l’entreprise est en réelle difficulté, elle fera sans doute l’économie d’une demande de concours financier sans espoir, faisant gagner à tous un temps précieux ;
- sinon, elle se présentera avec un dossier structuré, documenté, argumenté, de nature à réduire les comportements opportunistes, voire agressifs trop souvent observés sur le terrain. Le dialogue pourra s’engager avec un chef d’entreprise plus serein, en raison d'une lucidité accrue et sans doute d'une meilleure compréhension du vocabulaire, des contraintes et attentes de son interlocuteur bancaire.
Pour une pédagogie par la notation par la performance
Ainsi, deux acteurs peuvent intervenir pour préparer et accompagner un chef d’entreprise désormais mieux entouré : le conseiller (l’expert-comptable le plus souvent) en amont, la banque en aval. Dès lors, la notation devient un indicateur de performance à améliorer avant d’être une alerte d’anticipation du défaut. Elle peut mener à stimuler la réflexion et réorienter la stratégie : anticiper les difficultés, bifurquer à temps, pour sortir du « chemin de la défaillance ».
L’examen annuel de la note endogène permet en outre une approche temporelle dynamique. Ainsi, un score qui baisse de manière continue (par exemple sur trois années observées) révélera une entreprise entrant progressivement dans une zone de risque. Cette dérive appellera à réagir avant qu’il ne soit trop tard.
En outre, une alerte synthétique (la note), c’est bien, des clignotants ciblés sur les difficultés avec les explications associées et les actions correctives à mettre en jeu, c’est mieux. Leur examen attentif amène le dirigeant à agir sur les indicateurs qui passent au rouge.
On dépasse ainsi la problématique duale survie/non survie, pour des objectifs plus nuancés : progresser, se maintenir, ne pas régresser. Il y va de la pérennité de la PME et du chiffre d’affaires de ses partenaires.
Enfin, la démarche proposée enrichit et affine la mesure du risque. Les informations sur l’autonotation devraient pouvoir contribuer à réduire ce risque perçu, et dès lors à minimiser le poids de la classe de risque associée. Par voie de conséquence, le taux de couverture en fonds propres requis par les nouvelles règles prudentielles pourrait diminuer. Ne s’agirait-il pas là d’une spirale vertueuse ?
Vers un dialogue lucide
Au total, il s’agit bien de rapprocher la banque et son client, en atténuant autant que faire se peut les asymétries évoquées précédemment dans la relation banque-entreprise :
- un sur-pouvoir au profit de la banque, du fait de sa puissance (taille, statut), des compétences perçues ou supposées, du pouvoir de dire oui (argument marketing qu’elle met souvent en avant) ou non (c’est alors l’expression d’une dure réalité pour l’entreprise) ;
- un sur-pouvoir au profit de la PME, qui se défend comme elle peut, le plus souvent en jouant l’opacité ou en enjolivant la situation, cachant ainsi certains pans de sa réalité. En « trichant » avec son financeur, elle en vient à « tricher » avec elle-même, se mettant en danger en réduisant sa lucidité et sa capacité de réaction.
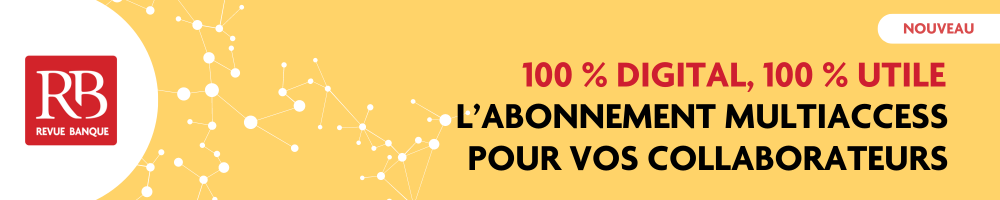

![[Web Only] Tarifs bancaires : les banques amortissent l’inflation [Web Only] Tarifs bancaires : les banques amortissent l’inflation](http://www.revue-banque.fr/binrepository/480x320/0c0/0d0/none/9739565/MEBW/gettyimages-968963256-frais-bancaires_221-3514277_20240417171729.jpg)




